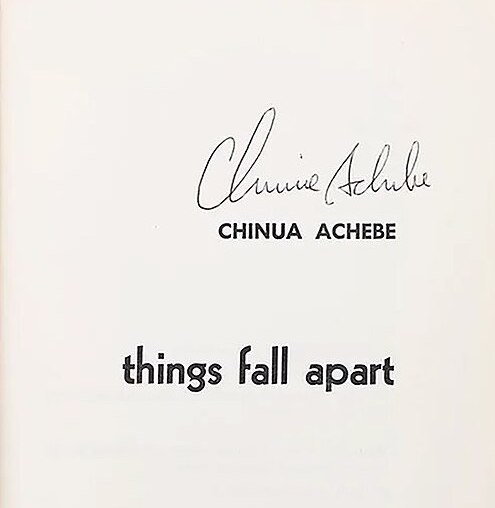Traduit de l’anglais par
Jessie Judith Ndjeya Nkouetchou et Patient Xavier Nong
Là où le soleil est à son zénith, là où se croisent toutes les routes principales de Kimboh, l’homme s’assied, le regard farouche. Le vent harmattan est arrivé avec des cadeaux magnifiques : des bouts de papier voltigeant dans la poussière tels des confettis lors d’un mariage. L’homme rassemble sous lui des ordures du tas d’immondices d’à côté pour en faire un coussin et dit : « Ici ! C’est mon territoire, ici, je suis le roi. » Son rire s’entend à travers le village. Tous les passants le fixent, et la plupart froncent le nez. Tout ce qu’il voit, c’est leurs esprits tortueux, pleins de méchanceté et d’hypocrisie. Alors qu’il perçoit l’aiguillon métallique rouillé de leurs murmures, un amas de salive se forme dans sa gorge. Il se lève pour cracher, mais change d’avis et décide de continuer à chanter dans sa tête. Chaque jour a sa mélodie ; celle d’aujourd’hui, c’est « Agatha ». Le trajet jusqu’à la maison d’Agatha l’amène à traverser Kimboh, vers la route qui mène au marché de Mbveh, le marché principal. Il regarde toutes les constructions et décide que la maison d’Agatha est la bâtisse la plus élevée, celle avec beaucoup de fenêtres. Agatha est son unique sœur, et il avait toujours pensé que si l’argent était une personne, il ressemblerait certainement à Agatha, ronde et fraîche comme une feuille de laitue bien arrosée. Elle pourvoyait à tous ses besoins : vêtements, chaussures, nourriture. Il ne se perdait jamais quand il allait chez Agatha.
L’homme s’appelle Edwin Amoben ; les gens l’appellent Amor. Certains l’appellent « mon père », ce qui le réjouit. Ce dimanche, comme la plupart des dimanches, il se retrouve à la St Martin’s Church, l’église située à quelques kilomètres de la place principale du village de Kimboh. Celle-ci est entourée d’un portail en fer de couleur verte, avec de petites fleurs alignées le long de l’allée rocailleuse. Dans l’enceinte, on trouve aussi le presbytère et la salle paroissiale. Amoben s’assied sur le banc en planches tout près de la chorale et, lorsque les choristes sont sur le point de chanter la deuxième strophe du cantique 107, il se met à taper du pied, les yeux presque fermés, puis entonne de sa voix de ténor puissante et limpide :
All you who thirst come unto me,
Come have some wine for free,
Hunger and thirst shall pass away,
Come unto your God.
Le dimanche, la St Martin’s Church est généralement remplie de gens qui lèvent la tête vers le ciel, comme s’ils attendaient Dieu. De sa place, Amoben peut voir la plupart des gens, en particulier le crâne nu et luisant de Pah Lucas. Esquissant un sourire éclatant, il se tourne vers le garçon assis près de lui et dit : « Mes problèmes sont aussi interminables que cette église. »
Les habitants de Kimboh chérissent le dimanche : c’est un jour de communion, un jour où les sourires sont adressés gracieusement, les réconciliations généreusement réparties, et chaque mets spécial dégusté religieusement, un jour où le vin de palme a meilleur goût. Dimanche est le jour préféré d’Amoben, pas seulement en raison de son lien à Dieu en tant qu’ancien séminariste, mais parce qu’il croit qu’il y a quelque chose de merveilleux à se rendre à l’église, à être dans un lieu où tant de personnes viennent purifier leur âme uniquement pour cette journée. Pour ceux qui, comme lui, n’ont jamais manqué une messe du dimanche de toute leur vie, c’est une habitude invariable. Dimanche est son jour de chance. Dimanche, le vent souffle différemment, le soleil brille moins violemment, et quand il pleut, la pluie vient par jaillissements successifs de bénédictions. Dimanche, les voix dans sa tête s’en vont ailleurs. Dimanche était le jour où tout avait commencé, le jour où il était certain que tout finirait.
Amoben descend le chemin de terre sinueux qui mène à la rivière, donnant un coup de pied au moindre caillou qu’il voit. De grands eucalyptus bordent le chemin des deux côtés, répandant un parfum de menthe fraîche légèrement étouffant. Il en coupe une branche, la met dans sa bouche et la mâche.
Je dois me laver les dents avant de me rendre au pays de l’homme blanc, pense-t-il. Cette rivière pourrait-elle me conduire au lieu où se trouve mon fils ? Au lieu où les sourires rayonnants de Njobati réchauffent mon cœur ? Aucun lieu n’est trop loin pour moi, pas même le pays de l’homme blanc. Mes jambes sont assez solides. Une, deux, trois… vingt, oui, je dois traverser vingt rivières avant d’y arriver ; je dois les voir.
Il est sur le point de traverser la deuxième rivière lorsqu’une forme se dessine devant lui. Soudain le vent se calme, nettoyant en douceur les parties nues de son corps ; il a oublié quelques-uns de ses vêtements sur la place du village. Il se balance d’une jambe sur l’autre, puis regarde à nouveau : il voit son bébé qui rampe lentement sur le pont légèrement cassé et instable, avec un sourire révélant sa première dent qui pousse. Il se précipite vers le bébé, puis s’arrête, pensant : Mon bébé doit se débrouiller seul ; mon bébé doit être libre et fort comme moi. Ensuite Amor avance à grands pas vers le bébé, mais avant de l’atteindre, il aperçoit Njobati. Elle tire le bébé vers elle et hurle : « Ne touche pas à mon bébé ! Va chercher tes vêtements ! »
Faisant fi d’eux, il va s’accroupir sur le rocher mouillé près de la rivière et dit : « J’étais censé être prêtre et distribuer la sainte communion à tous les villageois. » De fines gouttelettes de larmes ruissellent sur ses joues.
*
Encore une année avant d’être ordonné prêtre. En attendant, Amoben devait effectuer des travaux communautaires. Il décida d’enseigner dans une école locale. Y avait-il meilleur endroit que son Kimboh natal ? Il aimait la façon dont les belles collines étaient hautes et majestueuses, presque comme pour protéger le territoire, la manière dont chaque quartier semblait perché sur une colline, donnant l’impression qu’on montait ou qu’on descendait à chaque fois. Une terre aux conditions climatiques extrêmes : la poussière se collait à chaque chose et à chacun en saison sèche, et la boue emprisonnait les usagers en saison pluvieuse. Le temps semblait s’apaiser peu à peu à Kimboh. C’était un village de gens curieux, si proches les uns des autres, que l’on pouvait entendre distinctement des propos du genre :
« As-tu appris que Pah Pius n’est pas retourné chez lui la nuit dernière ?
— Oui, j’entends dire qu’il entretient une autre femme à Mbveh. »
La conversation pouvait s’étendre sur divers sujets pris au hasard. Il était content d’être à nouveau avec ces gens si aimables et accueillants, qui se sont toujours imaginé que faire vœu de chasteté et de pauvreté, porter une robe blanche, pouvait rendre quelqu’un « exceptionnel ». Il pouvait déjà sentir les fruits juteux de l’expérience qu’il aurait en servant sa communauté.
L’école était juchée au sommet de la colline. L’établissement était constitué de plusieurs salles disposées en forme de L. Au milieu de l’école, il y avait une cloche, un large dispositif en fer suspendu à un moignon. Il suffisait de lancer une pierre sur la cloche pour attirer l’attention des élèves. L’école était entourée de vastes champs qui ne demandaient qu’à devenir pâture. C’était une école si rarement pleine qu’il était possible de croiser tout le monde, élèves et personnel enseignant, au moins une fois par jour. Amoben avait choisi d’assister les élèves en mathématiques et en catéchèse.
Le jour de leur rencontre, il était assis devant la salle des professeurs, en train de réviser, quand Njobati et son amie s’approchèrent. Il ne se souvenait pas de l’autre élève, son nom ou même de toute leur conversation. Il se souvenait seulement de Njobati, de la façon dont ses yeux s’étaient plissés quand elle sourit.
Njobati Miriam vivait à quelques mètres de Kimboh Hospital, l’hôpital qui se trouvait à l’arrière du village. On appelait leur maison « la maison allemande », parce qu’elle était construite avec des murs blancs très solides et des colonnes en blocs à base de grosses pierres noires. Les nombreuses fenêtres vitrées ainsi que les larges et doux carreaux lui conféraient une touche raffinée et étrangère. Son père était un homme costaud, au teint noir, qui souriait rarement. Sa mère avait toujours une apparence négligée ; on eût presque dit qu’elle n’accordait de l’importance qu’à ses bijoux coûteux et à ses cheveux magnifiques. Ils étaient de fervents chrétiens catholiques, présents à toutes les messes ; nul n’ignorait que la place sur la troisième rangée de la deuxième colonne était la leur. Les chrétiens de la St Martin’s Church de Kimboh s’asseyaient toujours à la même place dans l’église, de sorte qu’ils pouvaient reconnaître un étranger à la place qu’il occupait.
Njobati avait toujours été très bonne élève, mais certainement pas en mathématiques. Elle en était très perturbée. Un vrai feu dans ses yeux embrasait tout ce qui résistait à sa beauté fragile. Sa peau d’une nuance de brun donnait l’impression qu’elle venait de prendre son bain.
Elle avait besoin d’aide en mathématiques. Apparemment, elle était promise à un bel avenir ; son futur s’annonçait manifestement grandiose. Amoben l’avait vue se battre encore et encore avec les chiffres. Il décida d’organiser des cours de soutien tous les mardis et samedis après l’école. Parfois d’autres élèves en difficulté avec les mathématiques manquaient à l’appel, mais elle était tenace. Une fois les cours terminés, elle faisait route avec Amoben, portant pour lui son sac jusqu’à sa petite hutte. Une attirance inhabituelle était ainsi née et l’avait pris au dépourvu, perturbant d’abord sa tranquillité, puis lui procurant la paix.
*
Amoben est assis au premier rang de la St Martin’s Church. Ses doigts évoluent par petits bouts, profitant de la sensation que procure chaque perle du saint Rosaire. Il y a longtemps déjà que ces minuscules perles blanches ne le quittent plus. Il lui avait fallu économiser longtemps pour acquérir ce précieux objet ; le révérend père Romanus l’avait ramené tout droit de Rome. Il interrompt l’égrènement pour se concentrer ; c’est le moment crucial, l’instant de purification. L’odeur de l’encens emplit son esprit, et bien que tout le monde soit assis, il se met debout, les mains levées, et dit à voix haute, en même temps que le prêtre :
« Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. »
Il ajoute un « cling, cling, cling » pour accompagner les traditionnels sons de cloches que l’on entend pendant la consécration.
À la fin de la messe, il se dirige en toute hâte vers la place du village. Juste à cet instant, il se rend compte que sa chemise, d’un blanc devenu presque marron, a besoin d’être repassée, que son pantacourt a besoin d’être boutonné, et aussi qu’il lui manque une chaussure. Il est sur le point de s’asseoir au pied d’un poteau électrique, mais il change d’avis. Il s’avance et s’assied près de la sculpture ancienne d’un fon « disparu » ; il semble qu’il a désespérément besoin de compagnie, celle d’une personne importante. Puisque c’est dimanche, les images affluent librement dans sa tête ; à l’heure actuelle, il s’y trouve encore.
*
L’atmosphère entre eux était toujours électrique ; elle était faite de cordes tendues prêtes à créer de nouvelles symphonies chaque fois qu’ils se touchaient. Chaque contact produisait diverses vagues de frissons sur tout son corps dont même la plus fervente neuvaine ne pouvait le délivrer. Le temps ce jour-là avait été glacial et rude. Toutes les années de son enfance à Kimboh ne l’avaient pas préparé à une telle grippe. Il était couché, grelotant, incapable d’aller à l’école. Njo lui avait rendu visite dans sa hutte. Elle portait un tee-shirt bleu pâle qui épousait généreusement ses formes. Cette image hantait ses pensées et ses rêves. Elle revint le lendemain, puis le jour d’après, pour l’aider à prendre ses médicaments. Ce jour-là, elle s’était assise au bord du lit pour l’aider à manger. Il se rapprocha, se disant que si elle reculait, ce serait un signe pour ne pas continuer. Elle resta là, sans bouger. Et lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, il la sentit trembler elle aussi. Tout à coup, leurs deux visages devinrent un seul, un visage qui n’avait pas existé jusque-là : le visage pur et tremblant du désir. Le baiser ne l’avait pas quitté, il était resté collé à ses lèvres comme du vin de palme fraîchement recueilli. Chaque fois n’était pas assez, alors il goûtait de ce vin, allant en peu plus loin à chaque fois…
Ce dimanche matin là, après être rentré au séminaire, il ouvrit la lettre qu’il avait gardée pendant des jours, puis il fixa les mots ; son cœur bondit et fit des sauts périlleux à n’en plus finir. Il fixa encore les mots, inclina légèrement le papier vers la lumière. Peut-être lisait-il mal, peut-être les rayons de lumière n’avaient pas touché tous les mots. C’était un jour ensoleillé, et bien que le soleil dansât comme une folle, éclairant tout, Amoben grelotait.
Mon cher Amor,
J’espère que tu te portes bien. M’as-tu oubliée ? Je prie depuis pour obtenir le pardon, comme tu me l’as demandé. La nuit dernière, j’ai même récité trente « Je vous salue Marie », bien que ne retrouvant pas mon rosaire. Le nouvel enseignant de mathématiques est très cruel : il m’a donné un zéro à son évaluation. Il parle trop vite, et lorsque nous nous plaignons, il efface rapidement le tableau. Tout le monde en classe se demande si tu viendras réviser avec nous avant les examens de fin d’année.
Il y a quelque chose que tu dois savoir : ma santé est précaire ces derniers temps. La plupart des matins, ma température est très élevée. Je dors beaucoup, surtout pendant les cours. Tout le monde s’en plaint, surtout maman. L’autre jour, j’ai brûlé toute la marmite de viande parce que je m’étais endormie. J’ai même vomi tout le contenu de mon estomac dans la cuvette des toilettes ; Dieu merci, il n’y avait personne aux alentours. Je pensais que c’était juste le paludisme, jusqu’à ce que j’aie un retard. J’ai des problèmes. Mes parents vont me tuer quand ils le découvriront. Reviens vite, j’ai besoin d’aide.
Cordialement,
Njobati.
Cette lettre déroba le sommeil d’Amoben. Manger n’était qu’une nuisance à laquelle il ne se permettait de penser. La lettre le hantait nuit et jour. Il n’osa en parler à personne d’autre ; la culpabilité était son nouveau collier, devenant plus petit, plus serré chaque jour. Il était devenu une incarnation de la trahison de Dieu. Dieu qui l’avait appelé, qui lui avait fait confiance. Il avait plongé Njobati et son bébé à naître dans une situation éprouvante. Les jours passèrent. La nouvelle ne le quitta pas. Elle pesait de tout son poids sur lui, assombrissant ses jours et le privant de tout espoir. La prière devint un cri lointain. Dieu l’entendrait-il ? Amoben était à présent son propre dieu, un dieu qui commettait des erreurs, un dieu perdu. Un dieu qui devait assumer ses actes.
Il fit ses bagages et quitta le séminaire. Nul ne savait s’il y retournerait. Il n’en était pas certain lui-même. On ne lui permit pas de la voir. Il ne put être à ses côtés quand elle souffrit seule : les métamorphoses physiques, la fringale. Il ne put pas la tenir dans ses bras et lui dire qu’elle pouvait compter sur lui. Le père de Njobati menaça de faire enfermer Amoben ; la seule chose qui le retint fut son grand respect pour l’église.
Amoben s’efforça de rester loin d’elle mais n’y parvint pas. Il se rendit ces jours-là à l’église pour voir si elle y était, pour être dans ce lieu qui apaisait son âme troublée, pour regarder bien en face ces gens qui désormais murmuraient sur son passage. Ceux qui étaient courageux lui demandaient le plus souvent :
« Mon père, quand allez-vous retourner au séminaire, que je puisse vous faire frire du garri à emporter ?
— Bientôt », répondait-il toujours.
Alors ils continuaient à murmurer, parce qu’il ne s’en allait pas.
Plusieurs mois s’écoulèrent. Parfois sur la pointe des pieds, sans bruit, alors qu’il engloutissait les boules de fufu corn que sa mère avait l’habitude de préparer. Parfois encore, les jours volaient inlassablement tels des oiseaux qui ne se perchaient jamais haut dans le ciel.
Ce jour-là, il faisait la grasse matinée. Il était resté silencieusement dans sa petite hutte, soupirant et ruminant sa peine. Il entendit frapper à sa porte mais resta coi. Il n’attendait personne ce jour-là. Comme les coups à la porte persistaient, il ouvrit et trouva là un petit garçon qui lui tendit un petit bout de papier. « Aunty m’a demandé de te remettre ça », dit-il.
Mon cher Père Amoben,
Cette lettre sera la dernière que tu liras de moi, car je m’en vais loin d’ici, très loin. Mes parents ne veulent pas de honte. Nous nous en allons. Nous partons pour la France dès que possible. J’irai dans un couvent. Quand papa a fait cette suggestion, j’ai pensé que c’était une bonne idée. Je dois m’occuper du bébé pendant qu’il sera à l’orphelinat. Je dois me repentir de mes péchés. Ne nous cherche pas, ça ne t’aidera pas. Et ne va pas parler du bébé autour de toi ; cela ne sera pas bon pour ma famille, l’église et toi.
Sincères salutations.
Il lut cette lettre à plusieurs reprises. Chaque mot était comme une lance qui s’enfonçait profondément dans son cœur, dérobant ses mots. Plusieurs mois durant, les yeux grand ouverts, il garda le regard fixé devant lui, s’accrochant toujours à son unique source d’énergie : le silence. Pas même Agatha ne parvenait à démêler les mots dans sa tête.
*
Le matin où Amoben commence à parler, le ciel se met à vomir sans crier gare. Il quitte l’église et se dit en lui-même : Cet endroit m’étouffe ! Pourquoi essaient-ils de me parler de Dieu ? Je sais qui est Dieu. Je l’ai vu quelque part dans ses yeux, pendant qu’elle me fixait. Je le vois dans l’air pendant que ces petites particules voltigent, se heurtant les unes aux autres. Il y a un moment qu’il n’a pas prié ; les mots ne sortent tout simplement pas. Ce jour-là, ils sortent par des cris sur la place du marché.
Il hurle :
« Njobati ! »
« Calamai ! » (En bon papa, il avait donné un nom à son bébé.)
« Nyuy Ta-ta ! »
Les spectateurs sont frappés d’étonnement. Pourquoi mêler Dieu à tout ça ?
Il se réveille le lendemain dans sa hutte, le corps entièrement trempé de sueur, assez pour remplir un puits. Des chaînes nouent son poignet et ses chevilles. Il s’interroge : Qui essaie de me retenir, et pourquoi ? Qu’est-ce que j’ai fait de mal ? Je veux juste voir mon fils et Njobati. Il tourne en rond dans sa chambre, mais ne parvient pas à reconnaître l’air putride qui y règne ; ses yeux piquent et se remplissent de larmes. Tout dégage une forte odeur de pisse, de sueur chaude et de quelque chose d’autre. Les deux principaux trous dans le sol lui sourient, et il peut les entendre lui dire bon retour. On peut imaginer qu’ils sont là depuis longtemps, comme une vieille plaie non soignée. Un vent fort pénètre dans la chambre en douceur, et avec lui une sensation rafraîchissante qui lui fait se demander s’il est endormi ou parfaitement éveillé. Il y a du mouvement autour de sa chaise. Quand il se tourne pour vérifier, il la voit assise sur l’unique chaise à bascule, Njobati avec bébé Calamai. Il essaie de briser ses chaînes, mais elles restent accrochées à lui. Il se débat, mais en vain. Le voyant se débattre, elle avance vers lui, puis, de son petit doigt, lui rend sa liberté.
« Repose-toi un peu, ça fait bien longtemps que tu te débats, dit-elle. À ton réveil, tu devras rentrer au séminaire. »
Amoben se couche et ferme les yeux. Un profond sommeil s’empare de lui. Il se réveille avec un seul objectif.
« Viens, allons sur la place du village ; tout le monde doit voir mon fils », jubile-t-il tandis qu’il prend son fils dans ses bras.
Ce moment magique peut faire d’un jour une éternité — les heures, les minutes, les secondes s’égrènent lentement. Si Dieu est amour et l’amour est Dieu, alors Njobati et Calamai étaient des dieux, ses dieux… l’objet de sa quête permanente et de son adoration. Pour lui, la vie est un fil brûlant aux deux extrémités, dont le feu n’atteint jamais le centre. Alors il attend et attend, jusqu’à ce que la chaleur l’envahisse.
“Dimanches Sains” est tiré de Le crépuscule des âmes sœurs