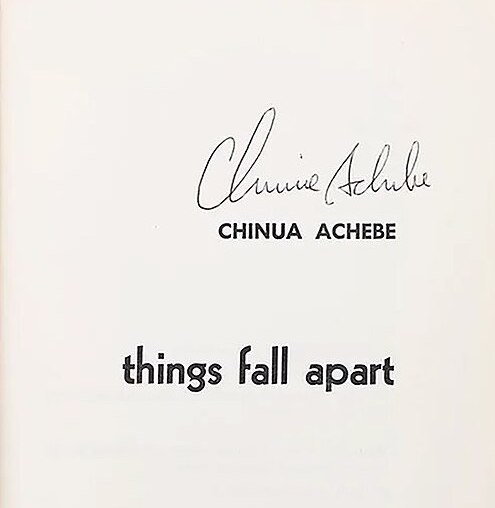« Elle est morte. »
Je ferme les yeux un instant. Inspiration, expiration. Je reprends mon souffle. La voix de ma sœur au téléphone me semble si… irréelle. Si lointaine, d’autant plus qu’avant cet appel, ça faisait bien cinq ans que je ne l’avais plus entendue. Dans un premier mouvement, je pense à raccrocher, mais elle a tôt fait de me signaler que c’est pour Mama qu’elle m’appelle. Je me retiens de pleurer car une femme forte ne pleure pas, mais ma mère était la seule personne pour laquelle j’éprouvais encore de l’affection dans cette famille.
« Les obsèques c’est pour quand ?
– Veillée tous les soirs et la suite du 24 au 25 de ce mois à la maison familiale et non au village.
– D’accord, je serai là. »
Je raccroche, je m’écroule. J’appréhendais fortement ce retour à Yaoundé, j’avais dit que je n’y mettrai plus jamais les pieds mais je n’avais pas pensé à la mort dans tout ça. Ayant prévu de n’assister qu’à l’enterrement, je prends ainsi la route le matin du 25, toute seule.
Le jardin n’a pas changé, les mêmes arbres sont toujours aux mêmes endroits. Toujours aussi bien entretenus par les bons soins de Mama, du goyavier aux fruits acides aux tiges d’aloès vera, en passant par le grand rosier rouge dont les fleurs ont toujours été fraîches et agréablement parfumées, même en saison sèche. Aucun flux inhabituel dans les alentours et encore moins dans la concession. Suis-je en avance ? J’ai un mauvais pressentiment en franchissant le portail. Je risque de ne pas aimer du tout ce qui m’attend et malheureusement mes doutes se fondent.
« Concrètement, les filles, qu’est-ce que je fais ici ? »
Je me tiens devant la porte d’entrée, mes sœurs et ma mère sont en train de discuter, oui ma mère ! Je les regarde tour à tour en attendant la courageuse qui pourrait m’expliquer ce qui se passe. Ngono notre aînée, qui m’a passé le coup de fil, regarde Mama. Mena quant à elle me toise comme à son habitude et a juste le temps de critiquer ma tenue qu’elle trouve trop osée pour un ‘‘enterrement’’. Abena est trop occupée à pianoter sur son téléphone pour s’intéresser à ma présence. Je suis venue pour le deuil de Mama mais de deuil, il n’y en a point. Je crois que j’avais oublié à quel point cette femme est rusée, mais de là à simuler sa propre mort pour que je revienne ? Je trouve cela juste pathétique. Une colère brusque m’envahit car les souvenirs enfouis en cette maison me reviennent peu à peu.
« Tu arrives, tu ne nous salues même pas ! Dounia tu nous détestes à ce point ? » lance Mama comme pour adoucir l’ambiance.
À contrecœur je leur tends la main à tour de rôle et je fais une accolade à Mama. Après avoir pris place dans le canapé, je réitère ma question. Sans perdre de temps, Mama prend la parole et dit qu’elle en a marre que nous vivions comme ça, chacune dans notre coin. Cinq ans que j’avais obtenu mon baccalauréat. Trois mois après ce visa pour ma liberté, je me suis mariée malgré leurs réticences et m’en suis allée dans le Sud avec mon mari, avec qui j’ai déjà deux enfants qu’elles n’ont jamais vu. Mama parle en pleurant. Quel mélodrame ! J’en suis presque émue. Depuis mon départ, je l’appelle presque chaque fin de trimestre et lui envoie de l’argent, c’est suffisant non ? C’est même par respect pour les neuf mois passés dans son ventre. Elle continue son baratin qui me fait plus bailler qu’autre chose tandis que je regrette d’avoir mis les pieds à ce “deuil” sans demander le programme des obsèques.
« Je ne compte pas passer ma retraite seule donc j’irai m’installer au village… avec votre père. »
Je ne comprends pas Mama, comment peut-elle se remettre avec un homme qui l’avait quittée parce qu’elle ne lui donnait que des filles ? J’étais la fille de trop, alors il est parti. Je l’ai vu quelques fois mais je ne l’ai jamais aimé bien qu’il ait essayé plusieurs fois d’être dans mes bonnes grâces. J’estime que la plupart des malheurs de mon enfance étaient sa faute, car il n’était pas là, car il n’y avait pas de testostérone ambulante pour tenir en laisse les hormones hystériques de ces femmes qui se déclenchaient chacune à leur tour et ne me laissaient de ce fait aucun répit. Être dernière-née est une malédiction et c’est pour cette simple raison que je me suis mariée si jeune, pour partir, fuir, m’évader, courir après un soupçon de bonheur bien que je ne sois pas encore amoureuse de mon mari à cette époque. Je serais allée n’importe où avec n’importe qui mais je n’aurais pas pu rester en ce lieu plus longtemps.
J’écoute d’une oreille le monologue de Mama, elle dit que nous pouvons déjà voler de nos propres ailes, que nous sommes grandes maintenant. En fait elle s’adresse particulièrement à Abena car c’est elle qui n’est pas encore stable d’après ce que j’ai pu comprendre. Éternelle étudiante ne voulant pas grandir, vivant en semi-concubinage, très immature, le cliché parfait pour illustrer l’irresponsabilité dans le dictionnaire maternel.
Mama prêche dans le désert, nous le savons toutes. Abena ne l’écoute qu’à demi-mot. C’est dans ce tableau que Mama, s’étant enfin rendu compte que son discours est vain, va droit au but et d’une voix douce annonce que j’hérite de la maison familiale. Mon énième bâillement est interrompu d’une façon nette, en pleine exécution. Ngono et Mena me regardent avec surprise et aussi surprenant que cela puisse paraître, Abena non seulement pose son téléphone mais aussi exprime calmement son mécontentement. Je suis née trois ans après elle et elle ne me l’a jamais pardonné, c’est pourquoi quand nous étions petites on devait tout nous acheter au même moment sinon elle se servait chez moi. En fait Abena et Mena étaient les pires, Mama et Ngono étaient juste trop laxistes et me laissaient me faire mater soit disant à cause du droit d’aînesse à respecter. Puis, Ngono est partie trop tôt en mariage, elle a quitté la maison à vingt ans alors que je n’en avais que cinq.
« Pourquoi céder la maison à une bâtarde ? »
Des larmes perlent au coin de mes yeux. À ses yeux, je ne suis donc qu’une bâtarde parce que notre père n’avait même pas voulu me reconnaître. C’en est trop ! Je m’en vais et cette fois-ci pour de bon. Elles peuvent la garder leur maison de tortionnaires ! Je me lève. Ngono se lève à son tour et applique une belle claque à Abena. Je m’arrête, la scène est assez choquante car Abena réplique aussitôt en faisant pareil. On aurait dit une droguée, ce qui ne me surprendrait pas. Ngono, très posée de nature se touche la joue, ce qui ne présage rien de bon mais Mama lui demande de se calmer. Contre toute attente Mena bondit sur Abena sans que je ne sache trop pourquoi et la roue de coups. Cette dernière ne se laisse pas faire et là sur le sol, je regarde mes grandes sœurs se taper dessus et je m’en fous. Je sors mon téléphone pour filmer la scène. Ça fait un bon souvenir à montrer à mon mari et, pour la première fois depuis mon arrivée, je rigole. L’issue de ce combat est difficile à pronostiquer puisqu’elles sont de corpulence et de force presque égales. Mama du haut de sa soixantaine d’années essaye de séparer ses filles. Je filme en riant. Ce n’est pas très noble de ma part mais jouer l’hypocrite et faire comme si je voulais y mettre fin non plus. Elles saignent du nez, à travers leurs vêtements déchirés par endroits, on aperçoit des traces de griffures. Elles n’y vont pas de main morte à ce que je vois. Les insultes ne sont pas en reste, des « sale pute », « parvenue », « n’importe quoi », « déchet » fusent entre elles. On les sépare enfin et Mena assène une dernière gifle.
« Ne la traite plus jamais de bâtarde tu m’entends ? Sinon tu ne pourras plus t’identifier devant un miroir.
– Ce n’est pas alors une bâtarde ? Essaye ! je n’ai pas peur de toi.”
Bon ! L’action finie, je peux rentrer. Mama me rappelle durement et sans me laisser le temps de répondre, elle me dit que je la déçois, moi et ma froideur envers mon propre sang.
Ma respiration s’accélère, mon cœur prend du volume, c’est donc moi la méchante ? Avec tout le respect que je lui dois je me mets à lui rappeler pourquoi j’étais partie. Dans mon enfance Abena m’avait fait vivre des galères, elle me frappait, me menaçait, prenait mes affaires, mais je me disais que ça arrive entre tous les enfants. Sauf qu’en grandissant, ça ne s’était pas amélioré. Ça avait même empiré. Quant aux paroles blessantes sur mon physique, Mena savait toujours quand et lesquelles utiliser pour me faire me sentir plus vermine que je ne l’étais déjà. Je n’avais pas le droit d’avoir des amis, je travaillais tout le temps afin de ne pas avoir le temps de sombrer dans l’oisiveté disait-elle, la bastonnade était inscrite dans ma routine quotidienne. Je n’avais plus de nouvelles robes, il me fallait attendre celles d’Abena, j’avais même appris à me faire des tresses toute seule car il n’y avait personne pour moi. Je ne sais pas ce qui avait changé mais personne ne m’aimait plus du tout. Je n’avais qu’une hâte, obtenir mon baccalauréat et m’en aller. Peu importe le moyen. Je priais Dieu pour qu’il m’envoie une porte de secours, cette dernière se matérialisa sous les traits de Souhiel. Un bel homme de trente cinq ans plein aux as. Je n’avais pas hésité. Bien qu’il fût marié, il fallait que je m’en aille. Ça n’avait pas été facile de me faire accepter par sa famille vu que je suis une fille du Centre. Cependant mon prénom “Dounia”, d’origine arabe, ma virginité et mes cheveux ondulés rappelant ceux des arabes Choua avaient joué en ma faveur. Il a été la lumière pleine d’espoir que la vie m’offrait et notre foyer polygamique avait marché à merveille, cet espoir ayant mué en bonheur. Seulement, ma famille ne l’a jamais su, elle n’aurait jamais accepté de donner ma main dans ces circonstances.
Je me mets à parler de toutes les punitions, des nuits blanches à garder les jumeaux de Mena, des jours noirs à rester sans manger, des après-midis ensoleillées où je n’avais pas le droit de sortir jouer avec ceux de mon âge. Pendant ma tirade, mes larmes comme des torrents dévalent mes joues, mon dégoût à l’encontre de toutes ces femmes ne cesse de croître. J’ai tellement à raconter qu’une journée ne serait pas suffisante, mais ça c’est parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je n’en ai pas parlé, j’avais besoin de me libérer pour une fois car avant, quand j’essayais, on me sommait d’arrêter de faire la victime. Ne l’étais-je donc pas ? Je faisais peine à voir. Je n’avais que 45 kg pour 1m68, à dix-huit ans. Je me demande encore comment Souhiel avait fait pour deviner que je n’étais pas laide pour de vrai, que je n’étais pas dans mon état normal. En tout cas, je l’avais toujours remercié de m’avoir fait sortir de là par la grande porte, de m’avoir honorée et fait de moi l’heureuse maman d’une paire de jumeaux. Une phrase d’Abena me fait sortir de mes tristes souvenirs.
« Tu comptes lui dire la vérité un jour ?
– Je suis fatiguée de garder le secret, tu vois bien qu’elle te déteste, dis-lui », ajoute Mama.
Je regarde celle vers qui tous les regards sont tournés. Elle pleure à chaudes larmes, se rapproche et m’enlace.
« Je suis désolée mon bébé, je ne voulais pas que tu sois comme moi, aussi j’ai toujours été dure avec toi. »
Je ne comprends pas bien car elle parle très vite, comme si elle court après quelque chose. Je m’écarte de son étreinte car je ne me sens pas à l’aise dans ses bras. Elle nettoie ses yeux d’un geste lent.
« “Dounia”, en arabe, signifie richesse, source de vie. Tu es ma vie. »
Je fais vite un calcul rapide, juste pour me rassurer que je ne suis pas en train de rêver… 36-23 font 13. Peut-être que je ne comprends pas bien mais est-elle en train de sous-entendre qu’elle est ma mère? Je leur demande à quoi elles jouent mais elles ne me répondent pas. Je n’aime vraiment pas ça. Mon cœur bat la chamade alors qu’aucun son n’est en mesure de sortir de ma bouche. Je fixe Mama et j’observe de temps en temps les autres pour qu’elles me disent que ce n’est pas vrai, que ce n’est qu’une blague… Non, nous ne sommes pas encore en avril.
À treize ans ? Était-ce un viol ? Elle répond par la négative. On se rassoit, Mama me ramène un verre d’eau parce qu’elle sent que j’en ai besoin. Mena, ma vraie mère, me raconte alors, le regard figé sur le mur de l’autre côté de la pièce que, ce n’était pas un viol mais une histoire d’amour. Ceux que j’ai toujours considéré comme mes parents vivaient à Garoua, tous les deux enseignants, et ils avaient demandé chacun à être affecté à Yaoundé. La demande de Mama aboutit avant celle de son mari. Elle dut alors partir avec les enfants à Yaoundé mais elles revenaient dans l’Adamaoua pendant les congés et les vacances en attendant l’affectation de Papa. Mena, à douze ans, n’était pas encore une femme mais elle tomba amoureuse d’un des fils du lamido et c’était réciproque. Un soir d’avril, ils faiblirent face à l’appel de leur chair, et le soir d’après également, ainsi que tous les soirs qui ont suivi ce soir jusqu’à la fin des congés de Pâques. Vers la fin des grandes vacances, grand-mère remarqua que ma génitrice prenait du poids, de la poitrine et un peu de ventre. Bien que ses premières menstruations n’étaient pas encore arrivées, Mama suspecta une grossesse et, après un test positif, Papa fou de rage les renvoya directement à Yaoundé. Il était cependant trop tard pour qu’une quelconque mesure soit prise car elle en était à quatre mois. Elle a dû accoucher de moi et mes grands-parents m’ont adoptée pour qu’elle puisse continuer ses études.
Je suis sous le choc. Celle qui m’a maltraitée toute une partie de ma vie est ma génitrice, celle qui dans la douleur m’a poussée de ses entrailles, celle dont j’étais censée être la prunelle des yeux m’a matée soit disant pour que je ne sois pas aussi précoce qu’elle et parce que mon père l’a abandonnée. Il n’était jamais venu la voir à Yaoundé comme promis et ça s’était arrêté là, elle ne voulait pas en savoir plus car il lui avait brisé le cœur. Ses larmes semblent sincères mais ça va être difficile de lui pardonner car il s’agit bien d’une vie et non d’une semaine à effacer. Les jumeaux de Mena sont en fait mes petits frères et Abena et Ngono sont mes tantes et elles le savent depuis tout ce temps ? Pourquoi être méchantes avec moi dans ce cas ?
Je n’ai dit mot durant cette confession. J’ai encore très soif et je me mets à gratter nerveusement mon cuir chevelu. Il est où mon père ? Il m’a vraiment abandonnée lui aussi ! J’imagine ce qu’elle a pu vivre à son jeune âge et je la serre dans mes bras pour la première fois dans mes souvenirs, juste pour ça. Son attitude vis-à-vis de moi m’a forgée et a fait de moi la guerrière que je suis désormais, même si je maintiens qu’elle y était allée trop fort. Mama, les yeux hagards, se lève et se place devant la baie vitrée ; récemment installée car je n’en ai aucun souvenir. Les deux autres femmes affichent un air soulagé et placide puisqu’elles ne portent plus ce secret en elles.
Cinq minutes passent dans le silence total. Mama brise la glace en nous invitant à table. Je veux refuser mais sa mine déconfite me l’interdit. Après tout, j’ai faim et un ragoût de porc avec du plantain pilé ne demande qu’à être ingéré. Il serait insultant de résister, de passer outre les gargouillis de mon ventre. L’ambiance du dîner est froide et calme, même Abena nous fait grâce de son téléphone et mange timidement. Elles ont dû comprendre que j’ai besoin de temps pour tout digérer et elles ont raison !
Une dernière pièce manque au puzzle : pourquoi grand-père n’est jamais venu vivre ici, n’a jamais été présent depuis plus de 20 ans ? Mena répond qu’il supportait mal le fait qu’elle soit tombée enceinte à treize ans, que ça lui procurait une sensation d’échec dans son éducation. Alors, pour ne plus avoir à supporter la vue de celle qui incarnait cet échec, il a préféré s’éloigner un temps. Il sait qu’il n’aurait pas dû, il regrette ses décisions passées et il m’offre la maison pour se faire pardonner. J’accepte son cadeau, surtout parce qu’Abena le voulait aussi et que c’est ma façon de me venger. J’ai également appris qu’il n’était pas venu à la réunion car c’était trop tôt pour moi. Après ce brillant échange sur mon grand-père, nous nous mettons à parler de sujets divers tels que la paix dans le monde et la protection de l’environnement. Suite à quoi, je décide de passer la nuit à la maison, le cœur moins lourd, et je songe même à revenir avec mes jumeaux pour les présenter à ma famille.
Il est un peu plus de dix huit heures, l’heure où se termine la sieste, où le ciel s’assombrit et les moustiques sortent de leur cachette. À cette heure là, où il est conseillé de parler en chuchotant, je vais dans la chambre de Mama lui poser quelques questions. Je ne suis pas dupe, je ne la connais que trop bien et je sais qu’elle n’a pas tout dit. Je la trouve en pleurs et, au sortir de cette chambre, j’ai perdu mon innocence : je suis désormais une des leurs.
*
Deux mois déjà que je suis rentrée de Yaoundé. Après une longue hésitation, j’ai décidé en fin de compte, grâce à Souhiel, d’aller dans la famille de mon père. Une fois à Garoua, je n’ai eu aucun mal à être conduite au bon endroit, vu leur popularité et la bonne volonté des gens de la région. J’ai laissé mes cheveux flotter au gré du vent pour l’occasion, qu’ils voient que je suis une des leurs. Au lamidat, ils connaissent bien Bilal Abdel mais il a disparu depuis longtemps, très longtemps. Une jeune fille me conduit vers la case de celle que je devine être sa mère vu son âge. Elle m’accueille en disant qu’elle sait qui je suis, je souris. Elle dit que je ressemble à sa mère à elle. Je donne mon nom après qu’elle m’ait donné le sien, elle m’informe que je suis décidément la réincarnation de sa mère qui s’appelait également Dounia. Je me sens directement à ma place. Elle me parle de son fils, mon père. Il avait pris le train pour Yaoundé, disant qu’il lui réserve une surprise, mais il n’était jamais revenu, plus aucune trace de lui. Je lui narre la jolie version officielle : ma mère m’a détestée toute ma vie parce que mon père l’avait abandonnée à treize ans avec une grossesse dont il était heureux au départ. Je pleure, car ce n’est pas juste pour une mère d’ignorer où se trouve son enfant, mais comment lui dire que son fils n’a pas été lâche ? Comment lui dire qu’il repose actuellement, et ce depuis plus de vingt ans, dans le jardin de mes grands-parents, en dessous du rosier aux fleurs éternellement rouges et de quelques tiges d’aloès vera. Comment lui expliquer qu’il a été brutalement arraché à la vie par mon grand-père qui, l’ayant pris pour un bandit, l’avait poignardé car il s’était introduit dans le camp résidentiel peu après minuit, afin de rencontrer furtivement Mena. Il n’avait pas l’intention de tuer le jeune homme mais ce dernier s’était rapidement vidé de son sang, il n’avait que dix-huit ans… Mon grand-père, ma grand-mère et moi partagerons ce secret jusqu’à la mort. C’est ainsi. Et tant que ce sera ainsi, j’aurai désormais mes deux familles à mes côtés.
“Il était temps ” est tiré de Bakwa 10: Family Politricks
Cliquez ici pour acheter ce numéro