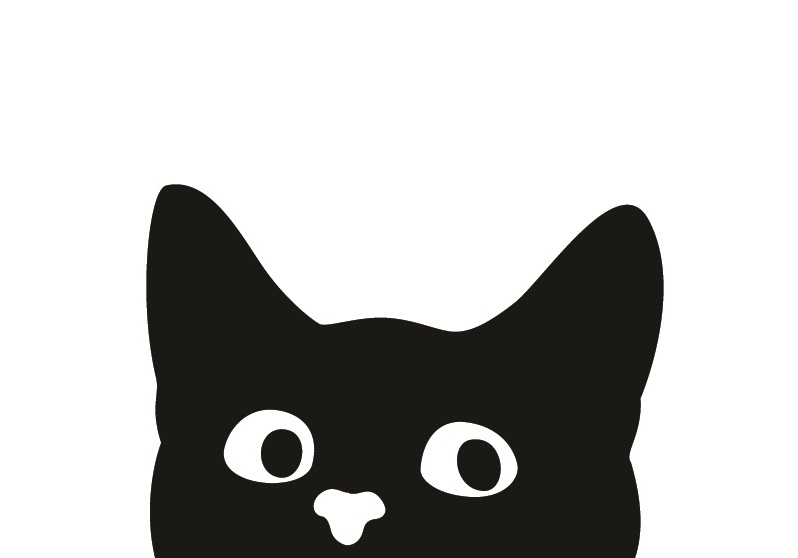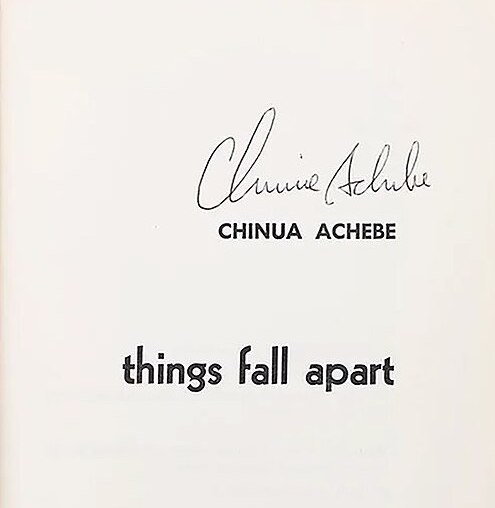Image: Crazy nook ( shutterstock)
On me dit que le pays est anémié
Les vampires l’ont vidé de son sang
Que bientôt le rideau des ombres
Nous séparera de lui
— Géraldin Mpesse
« Libérez donc l’entrée, bande de vandales ! » hurla le garde du corps du recteur en repoussant la foule de son bras droit. Il ouvrit la portière de la grosse Prado noire. Le patron de l’université, un homme aussi condescendant, qui n’avait jamais accordé l’audience à un étudiant depuis que le décret l’avait hissé à ce rang, en sortit, enfila sa veste grise et ajusta le nœud de sa cravate rouge. Il entra dans le hall de son cabinet. Ruben, le président du Parlement, le poursuivit en s’écriant : « Notre lettre, Monsieur le Recteur ! » Un vigile le bouscula et lui asséna un coup de poing en pleine poitrine. Le coup résonna dans ma tête comme l’écho d’un tambour bamiléké. Ruben recula, plié en deux, haletant sous la douleur, se massant la poitrine. Après un certain temps, il se redressa et siffla. Au loin, noyé dans la brise froide de ce matin de juin, un bruit se fit entendre du côté du grand stade de football, allant en s’amplifiant. Je grimpai sur un poteau et m’élançai sur le faîte d’un toit pour voir ce qu’il en était, mais l’épais brouillard masquait le spectacle. Le virus de la curiosité était là, me hantant, me collant à la peau tel du parfum haoussa. Un essaim d’abeilles, dont j’ignorais la provenance tout autant que la destination, passa au-dessus de ma tête dans un bourdonnement inquiétant. Pris de panique, je regagnai le sol d’un bond.
C’est là que je les vis. Une forêt d’étudiants grimpait la colline qui traverse la cour de l’amphithéâtre 502, certains munis de pancartes, d’autres de couvercles de marmites. Ils chantaient d’un ton mélancolique : « Nous sommes les oubliés de la Nation… mais c’est dans la rue que toutes les batailles se gagnent ». Ils reprirent à l’unisson, moult fois ce refrain, telle une rhapsodie du malheur : « La rue est le pupitre où les marginalisés chantent leur misère ». Sur les pancartes, on pouvait lire : Monsieur le Recteur, l’histoire nous parle d’elle-même. Pensez-y. Comme nous, vous avez été étudiant dans cette université…
Le soleil, tardait à darder ses rayons sur Yaoundé, mais les étudiants transpiraient à grosses gouttes. Assis sur une termitière, je regardais la scène avec indifférence, car j’avais peu de foi en un changement émanant d’hommes aussi nonchalants que des escargots. On aurait dit des fidèles du Corpus Christi suivant la grande hostie. Probablement incapables d’arracher le moindre nul face aux vigiles fumants de rage et brûlants de montrer au recteur qu’ils faisaient leur travail avec abnégation, et que lui, Monsieur le Recteur, n’avait rien à se reprocher, surtout venant des étudiants, éternels plaignants.
Les voyant ainsi, il me vint à l’idée de leur dire d’arrêter de faire les cons et d’inspirer la pitié, comme s’ils étaient des quémandeurs de leurs droits, que les cris des petites bêtes sont de douces chansons aux oreilles des prédateurs qui veulent les dévorer, que le monde n’entend ni les cris ni les pleurs. Je descendis de la termitière et les suivis. Un coup de sifflet retentit et, à l’unisson, ils poussèrent un grand cri, renforcé par une cacophonie agaçante d’écho de bidons et de résonnement de couvercles de marmites.
J’aurais pu m’éloigner dès le commencement de cette histoire, quand Ruben faisait du porte-à-porte pour annoncer à nos voisins que c’était ce jour le point culminant du ras-le-bol ; qu’ils en avaient plein le cœur, que ça passe ou ça casse, Etoudi, le centre du pouvoir, entendrait enfin leur cri.
Même s’ils avaient raison, ce n’était pas pour autant qu’ils allaient risquer leur vie. Pour quasi rien, une licence, un master ou un doctorat qui n’ouvraient pas sur grand-chose. C’était trop osé, putain ! Nombre d’entre eux aurait mieux fait de rentrer dans les villages, rejoindre leurs parents et défricher bananeraies et cacaoyères, s’échiner dans les champs de mil, de sorgho ou de café.
*
Ôter sa chemise, exhiber ses gros muscles, intimider les étudiants. On aurait dit que Champi, le gros vigile, n’attendait que ce genre de situation pour se venger de tous ses combats perdus dans les rings de boxe, du temps où il aspirait à une grande carrière. Il se bomba la poitrine en exhibant ses pectoraux qu’il faisait tressauter, se mordit les lèvres et roua une dizaine d’étudiants de coups de poing. À cause de ses cinquante-six ans masqués par engouement pour les activités sportives et d’un embonpoint bien prononcé, il s’essouffla très vite et finit adossé contre un tronc de papayer, les mains sur les genoux. Alors qu’il se redressait, un énorme caillou percuta sa nuque…
Une sirène se fit entendre depuis le Château. Je fus pris de panique et me recroquevillai sous la Prado. Deux énormes camions de la police antiémeutes entrèrent dans le Campus à tombeau ouvert et se garèrent sur l’esplanade devant le rectorat. Ils semblaient avoir été prévenus… Chaque policier cagoulé qui en descendait, tenait dans la main gauche un bouclier antiémeute, et dans la droite un gourdin. D’une pichenette, l’un d’eux décrocha une bombe lacrymogène dont il aspergea le premier rang d’étudiants. Ceux-ci se dispersèrent comme une colonie de termites sortis de terre. Un autre asséna un coup de ceinturon dans le dos de Ruben. Sa chemise déchirée laissa entrevoir un énorme hématome formé quasi instantanément. Il tomba, toussota, un filet de sang sur le menton. Ses compères accoururent en essaim et l’emmenèrent. Un frisson me parcourut. L’indignation qui grondait en moi me souffla que je pouvais faire quelque chose pour ces pauvres étudiants. Non, plutôt faire quelque chose pour nous, pour sortir de cette misère orchestrée, volontairement, par le Recteur et le Chef de la Restauration pour s’offrir des Fortuner dernier cri, des séjours avec des wolowoss dans les hôtels huppés de Kribi, ou des vestes haute couture chez Gucci ou Kenzo.
Je fis un grand bond en avant, atterris sur la haie de fleurs et aveuglai ce couillon de policier d’un seul jet de salive. Il s’écroula en hurlant : « Mes yeux ! »
Je voulus capituler, de peur de recevoir une balle dans la tête. Mais il me souvint que la victoire s’arrache au bout du combat.
Ruben et moi avions quitté Etam-Bafia en octobre pour nous installer dans la cité universitaire et bénéficier des repas du Restaurant. À Etam-Bafia, je vivais des restes de notre voisin Zang, un militaire à la retraite.
L’annonce par Ruben de ce changement de quartier avait déclenché quelque chose en moi, comme si je venais de briser les chaînes de la misère qui me maintenaient captif dans ce nauséeux et immonde bidonville. Oui, la misère d’Etam-Bafia était aussi légendaire que l’opulence de Bastos. Je crus d’emblée qu’il avait décroché un emploi, puisque je n’avais aucune idée claire sur ce qu’était la Cité U. Ce nom me faisait penser à des rues pavées jouxtant de hautes barrières couronnées de barbelés, à l’intérieur desquelles les toits végétalisés laissaient à peine entrevoir les villas et châteaux qu’ils surmontaient. À l’époque, ce déménagement me donnait l’impression d’être un fils de pauvre adopté par un riche.
Nous nous installâmes à la Cité U un 14 octobre, dans la chambre A14. Je réalisai enfin qu’il s’agissait de la Cité Universitaire. Un sentiment de désolation naquit en moi, mais ça valait la peine d’y vivre. Pour la première fois, je séjournais dans un habitat avec un vrai plancher et des murs en parpaings de ciment. Je me retrouvais désormais au milieu d’équipements dont j’ignorais le nom.
Le premier mot que je mémorisai fut « placard », car mon voisin de chambre y rangeait souvent quelques provisions pour moi. En face du lit, il y avait, sur l’étagère en rotin, une cuisinière à gaz que Ruben avait achetée chez Artur, un enseignant en cours d’intégration qui avait été affecté à Ngarigombo. Acquisition inutile, car jamais, au grand jamais, je n’avais vu de feu allumé dans cette pièce.
*
La certitude d’une défaite prenait forme pour les étudiants téméraires qui tenaient encore tête aux policiers. Ils regardaient leurs camarades se tordre de douleur. Bras fracturés, dents cassées, portraits refaits.
Je décidai de rentrer.
Comment continuer de vivre dans ce mouroir ? Un mouroir où l’herbe poussait sans gêne à l’entrée même du Restaurant universitaire. Un Restaurant où la moisissure rampante rongeait des murs qui donnaient l’impression de souffrir de la lèpre. Je traversai sa cour, revoyant, comme dans un rêve éveillé, ces étudiants-là qui se bousculaient dans les rangs. J’y allais chaque midi et soir pour ingurgiter des morceaux de poisson, des lichettes de pain, des grains de riz qui restaient collés dans l’assiette d’une étudiante qui, soit par vantardise, soit par manque d’appétit, abandonnait son plat. Je m’en délectais.
Dieu est miséricordieux ! Alors que je traversais la cour, je trouvai un avocat sur mon chemin. Pendant que je le savourais, j’entendis un hurlement d’agonisant à une dizaine de mètres. Être humain ou bête ? Une brise souffla et abaissa les buissons. Je vis un homme dans l’herbe, vêtu de kaki et imaginai qu’il s’agissait d’un policier, à coup sûr. Je m’essuyai la bouche d’un revers de langue et courus répondre à l’appel du hurlement.
Le policier étranglait Awulu, notre voisin de la chambre D14. L’étudiant respirait à peine. Les yeux lui sortaient des orbites. Mais, curieusement, pas une seule larme ne ruisselait sur ses joues. Pourtant, son agitation montrait à suffisance que la douleur était à son comble. Cette ignoble scène faisait penser à un porc faisant son ultime adieu entre les mains d’un boucher. Un frisson me glaça le sang. Le policier le lâcha. Il inspira une bouffée d’air et toussa à répétition, essaya de s’enfuir ; mais le policier le coinça contre une balustrade, lui donna un coup de pied dans le dos et lui demanda : « Fils de pauvre, quel niveau fais-tu ici ? » Awulu ne pipa mot, il continuait de respirer comme un agonisant dans l’attente de l’onction des malades. « C’est à toi que je m’adresse, imbécile ! Tu ne parles pas ? » lança-t-il d’un ton impérial. L’étudiant avala sa salive deux fois et parla d’une pauvre voix brisée : « Je suis… Je suis… au niveau 4, chef ». Le pied écrasant la cuisse de sa victime d’une méchante botte noire, le policier sortit un paquet de cigarettes d’une poche de son treillis, en retira une sèche, l’alluma, l’aspira et, après plusieurs secondes, rejeta une épaisse fumée dans l’air. Ensuite, il sortit un sachet de whisky King Arthur de la même poche, l’ouvrit d’un coup de dents et but d’une traite. Awulu le regardait du coin de l’œil comme s’il voulait lui demander de lui passer son mégot. « Mon petit, à la guerre comme à la guerre. Tu m’entends ? En attendant qu’avec tes diplômes, tu deviennes sous-préfet, préfet ou gouverneur, je te mets d’abord au pas. Tu vas répéter après moi. C’est un exercice facile. Allons-y : le CEPE dépasse la Licence. Répète ! » Il toisa le policier et celui-ci le gifla si fortement que les empreintes de ses doigts se gravèrent sur son visage. Deux colonnes de larmes dégoulinèrent de ses yeux et stagnèrent sur sa lèvre supérieure. Le policier tenait à ce qu’il exécute son ordre. « Le CEPE dépasse la Licence. Répète ! Encore… » intima-t-il derechef. On aurait dit que le mot CEPE n’existait pas dans le vocabulaire d’Awulu. Il refusa de parler. Je les contournai et me rapprochai discrètement. Caché derrière un manguier, en face du policier, je fis crisser les feuilles mortes sous moi. Quand il leva les yeux, je bondis et j’y crachai. Il perdit la vue à l’instant. Je pris la clé des champs.
Un policier caché derrière un palmier, l’index sur la gâchette, interpellait un collègue qui passait par-là : « Il est temps, oh, mon frère ! Il est temps que nous passions à la vitesse supérieure ! Je sens en moi une folle envie de presser les seins d’une jeune étudiante, comme une éponge. Quitte à ressentir la raideur de ce petit noyau qui s’y forme souvent ».
Son collègue ne pipa mot. Il continua son chemin comme si ce n’était pas à lui qu’on s’adressait. L’autre sortit de sa cachette et lança : « Bon sang ! As-tu déjà assisté à un massacre sans viol ? Tu n’es qu’un sale traitre ! »
Sur ce, il s’en fut.
Je le suivis.
Il déambula longtemps sur le campus sans apercevoir la moindre silhouette d’étudiante. Il vit enfin des vêtements de femme accrochés sur une timide corde à sécher au deuxième étage du bâtiment D. Arme en bandoulière, il courut comme un drogué, frappa du pied deux fois la porte de la chambre D24. Les paumelles s’arrachèrent, éventrant la structure. Il entra précipitamment. Mais il n’y avait personne.
Il se caressa le pubis et la fermeture de son pantalon gonfla d’un coup. Du revers de la main, il balança la boîte à maquillage qui était posée sur la fenêtre, éparpilla les papiers sur la table, vida la bouteille d’huile végétale par la fenêtre. Il balaya la chambre du regard et riva ses yeux sur le lit. Il y avait un slip étalé à côté d’une serviette. Repoussant son arme dans le dos, il prit le slip et le porta à son nez, le huma dévotement, tel un prêtre baisant le corporal. Le brandissant au-dessus de sa tête, il le scruta comme pour localiser quelque chose. Quoi donc ? Des tâches de menstrues ? Des pertes blanches ? Caché derrière la porte, j’étais curieux de savoir ce que ce pervers en ferait.
Je suivais des yeux chacun de ses mouvements. Il redéposa le slip sur le lit et ouvrit sa braguette, le reprit et frotta son immense pénis tordu à l’endroit où se pose le vagin. Très vite, ce fut le cri de soulagement. Je fus ébahi de le voir se comporter comme un tordu en manque de sexe, alors qu’il portait une alliance à son annulaire gauche. Le policier remit son sexe à sa place et se jeta sur le petit lit de tout son poids. Il y resta longuement, sans bouger. Je crus qu’il était mort. Mais il se releva bruyamment, s’essuya le visage tout en fixant le sol devant lui. Son regard s’attarda sur le petit Jésus sur un mur, cloué sur une croix en bois rongée par les charançons. Il me vint à l’esprit d’employer mon arme secrète contre lui, mais je me retins.
Il ouvrit le petit frigo, se saisit d’une bouteille de jus entamée, la but à la trompette puis sortit, avec la mine d’un soldat ayant accompli sa mission. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, pensai-je en sortant de ma cachette pour saisir le paquet de bifaga posé sur l’étagère. Je l’ingurgitai en un clin d’œil. Au sortir de la chambre, je ne sus quel chemin avait emprunté le policier, pourtant, je venais d’entendre un toussotement percer le silence. Était-il allé à la recherche d’une autre proie ?
Les bifaga m’avaient laissé sur ma faim. À la recherche d’une quelconque pitance, je fis le tour du bâtiment et crus entendre la voix de Ruben. Je fonçai vers notre chambre. Hélas, rien ! J’hallucinais.
Était-il encore vivant ? Je le savais combattif et persévérant.
Semblant répondre à un appel, je grimpai la colline surplombant le lac Obili. Au sommet, des types scrutaient le campus. Des blocs-notes, des dictaphones, des caméras. Des journalistes. Celui apparaissant comme leur chef semblait en colère. « Quel gâchis ! » s’écria-t-il en hochant la tête. « On m’a pourtant dit que les étudiants saccageaient les amphithéâtres ! »
Caché dans les fourrés, je m’endormis.
À mon réveil, la nuit était presque tombée. Je me rendis à Obili, dans la rue des bars, des grillades et du poisson braisé, pour quêter mon repas du soir. À l’entame de la rue, devant une boutique-bar, un journaliste pérorait dans les haut-parleurs d’un poste radio. Il affirmait que les policiers avaient donné une leçon de morale aux étudiants qui saccageaient les amphithéâtres. Un ivrogne qui écoutait lança : « Les longs crayons dérangent. Ils se plaignent trop. Ils pensent que qui vit mieux dans ce pays ? Hein ! Depuis qu’Ahidjo est parti, nous supportons juste. On va alors faire comment ? » Les gens acquiesçaient.
À Mirador, les clients se trémoussaient entre les tables. Les pas de danse qu’ils exécutaient donnaient l’impression qu’ils avaient tous noyé leurs soucis du matin. J’entrai dans le bar. J’avais repéré un plat de poulet abandonné sous une table. Esquivant adroitement les jambes en mouvement, je réussis à atteindre mon objectif et me saisis d’un pilon entamé, dégoulinant de condiments que je léchai au passage. La musique s’arrêta tout à coup et j’entendis le jingle du journal de vingt heures. Je laissai tomber l’os retenu par mes mâchoires. Le premier journaliste annonça les titres. D’une voix rassurante et intelligible, le second lut le décret présidentiel : « Est, à compter de la date de signature de la présente décision, nommé au poste de Recteur de l’Université de Yaoundé 1, Monsieur Issoplo Pierre, professeur titulaire des universités, précédemment en service au Ministère de l’Enseignement Supérieur, en remplacement de Monsieur Minale Paul, révoqué de ses fonctions. » Je miaulai de bonheur. Quelqu’un remarqua ma présence et me balança un coup de pied rageur tout en hurlant : « Depuis quand on laisse les chats entrer dans ce bar ? »
Je bondis, le poil hérissé, prêt à cracher.
“Une bataille aux crachats” est tiré de Le crépuscule des âmes sœurs